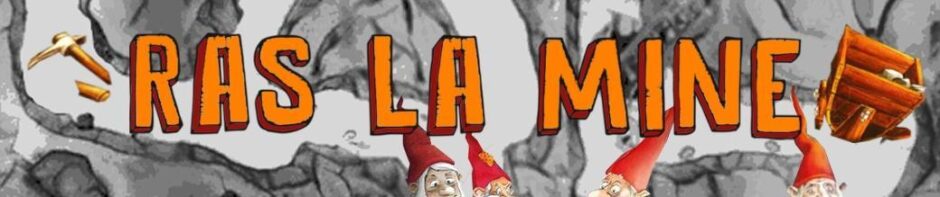[définition pompées sur eau-et-rivieres.org]
Un permis exclusif de recherches de mines (PERM)
Concession de mines
Lien entre PERM et concession de mines
Les travaux d’exploration
Déchets
Drainage Minier Acide (DMA)
Minerai
Résidus miniers
Stériles
Un permis exclusif de recherches de mines (PERM) :
C’est un titre minier qui donne à son titulaire et à lui seul le droit d’effectuer tous travaux de recherches des métaux déclarés dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des essais. Il est accordé pour une période de 5 ans maximum, renouvelables 2 fois, donc 15 ans.
Le pétitionnaire doit prouver qu’il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploration et pour assumer ses obligations en termes de sécurité, protection de l’environnement, etc.
Les prospections ne peuvent être effectuées sur les propriétés privées (particuliers, collectivités, entreprises, syndicats, associations, etc.) qu’avec l’accord du propriétaire de la ou des parcelles.
En cas de refus du propriétaire ou de l’exploitant de la parcelle, une indemnisation est possible ou bien, dans certains cas précis, l’acquisition de la ou des parcelles.
Cela reste une question de choix personnel, sachant qu’en général les indemnisations par l’Etat ou l’entreprise ne sont guère généreuses. Ce dispositif peut être activé pour quelques parcelles, mais s’il y a plusieurs centaines de refus ?
Au terme de la première période de 5 ans :
• soit les recherches n’ont rien donné et l’entreprise arrête les frais,
• soit l’entreprise a collecté des informations encourageantes mais pas assez précises et elle demande une prolongation,
• ou bien elle estime avoir assez d’éléments pour préparer un dossier en vue d’une demande de concession.
A noter que la surface du PERM peut être réduite au moment de la prolongation pour se concentrer sur les secteurs les plus prometteurs. Au final, plusieurs secteurs d’intérêt peuvent être identifiés au sein d’un seul permis, aboutissant à plusieurs demandes de concession.
Les porteurs de projets argumentent qu’il ne se passerait rien avant 10 ou 15 ans, et qu’il s’écoulerait 25 ans avant l’ouverture de mines. Qui aime jouer à la roulette russe ?
Concession de mines :
Une fois que les travaux d’exploration ont permis d’identifier un ou des gisements économiquement viables, la start-up qui a porté le PERM a généralement soit été absorbée par un groupe minier ou bien a vendu son titre à un groupe minier. C’est lui qui dépose la demande de concession en tant que pétitionnaire.
Une concession est un titre minier qui autorise son détenteur à exploiter une mine, d’un point de vue administratif. Elle implique l’organisation d’une enquête publique et, depuis peu, la production d’une analyse environnementale, économique et sociale. Le pétitionnaire doit prouver qu’il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et pour assumer ses obligations en termes de sécurité, protection de l’environnement, etc. Vu les impacts actuels des anciennes mines fermées mais toujours extrêmement polluantes, on peut s’interroger sur la capacité à réglementer de tels phénomènes…
Une concession est accordée pour 50 ans maximum et peut être prolongée de deux fois 25 ans maximum soit 100 ans au total.
D’autre part, pour pouvoir engager les travaux d’extraction, le pétitionnaire doit faire une ou des demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers. Si ces travaux sont considérés comme problématiques pour l’environnement, la santé, la sécurité, les bâtiments, voiries, etc… (mais la barre est très, très haute …), ils sont soumis à autorisation environnementale avec production d’une étude d’impact et font généralement l’objet d’une enquête publique conjointe avec celle de la concession. Les travaux à « dangers ou inconvénients faibles » (soit la plupart) soumis à déclaration.
Lien entre PERM et concession de mines :
Le porteur de projet et la préfecture nous répètent sur tous les tons de la gamme que nous mélangeons tout en affirmant qu’un permis de recherches de mines ou PERM est l’antichambre d’une concession, qu’il ne permet que de faire de l’exploration, d’accumuler de la connaissance, que seuls 5% des PERMs débouchent sur une mine et que de toutes façons, il ne se passera rien avant 15 ou 20 ans. So what ?
Le problème est que l’article L132-6 du code minier dit bien que : « Sans préjudice de l’article L. 142-2, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci. ». Ce que l’Autorité environnementale reprend ainsi dans son avis de février 2025 en page 14: « L’octroi d’un permis exclusif de recherches par le ministre chargé des mines donne à un industriel, et à lui seul, le droit de mener des recherches pendant la durée sollicitée, puis de déposer des demandes de concessions minières dans le périmètre ayant fait l’objet de ses recherches ».
C’est d’ailleurs ce qu’on appelle le « droit de suite » dans la profession. Il y a certes un « taux de perte » important entre PERM et concession, mais, au regard des conséquences irrémédiables de l’ouverture de mines pour un territoire, sa population, son avenir, qui a envie de jouer à la roulette russe ?
Sachant que, même si l’Etat décide de refuser l’octroi d’une concession, le pétitionnaire ne lâche pas le dossier. Il va systématiquement devant les tribunaux, arbitraux de préférence (n’oublions pas qu’il s’agit de majors internationales avec des moyens financiers certains) et des procédures interminables s’ensuivent qui aboutissent généralement à des pénalités faramineuses imposées aux états par les juges
commerciaux.
Les travaux d’exploration :
Les travaux d’exploration, autorisé dans le cadre du permis de recherches de mines ou PERM, sont de plusieurs nature.
Dans un premier temps :
• des recherches bibliographiques sont menées.
• Puis le territoire est quadrillé tous les 400 ou 200 m par des équipes de prospecteurs qui réalisent des prélèvements de sol pour analyse minéralogique, afin de localiser et cartographier les zones d’intérêt potentiel. Cette opération implique de pénétrer dans les propriétés privées, avec l’accord obligatoire des propriétaires ou des exploitants.
• Les informations peuvent être affinées par des campagnes de géophysique menées depuis un hélicoptère afin de mieux localiser les secteurs métallifères.
• Un levé cartographique des caractéristiques géologiques des secteurs d’intérêt est réalisé par des géologues au sol.
Ces étapes ne nécessitent pas d’autorisation administrative mais sont conditionnées par celle du propriétaire ou de l’exploitant.
Dans un second temps :
• des campagnes de forages de reconnaissance sont réalisées pour confirmer la présence de zones d’intérêt et leur volume, elles permettent de prélever des échantillons qui seront analysés pour constituer une base de données.
Ces travaux sont soumis à autorisation s’ils :
• provoquent un terrassement total d’un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ;
• entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol ;
• ou bien s’ils impliquent des forages de plus de 100 mètres de profondeur, sauf s’il s’agit de forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, de forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols … donc, ça n’est pas trop contraignant.
Par contre, tous les forages de plus de 10 m doivent être déclarés auprès du BRGM pour alimenter leur base de données, sans que cela implique aucune contrainte réglementaire.
Selon la technique utilisée, la profondeur des sondages envisagés peut dépasser 300 m. De par leur nombre, leurs profondeurs et leurs diamètres, les volumes extraits peuvent atteindre plusieurs centaines de m³ de roche.
Ils doivent être rebouchés conformément à la réglementation en vigueur qui vise essentiellement les forages géothermiques, d’approvisionnement en eau, etc. Elle n’intègre pas les caractéristiques spécifiques des formations géologiques riches en métaux et les risques de contamination chimique via les déchets générés.
Dans son dossier de demande de 2024, le porteur de projet, Breizh Ressources précisait qu’en cas de découverte de minéralisations potentiellement économiques, elle demanderait le renouvellement du permis afin de réaliser des forages supplémentaires dans la ou les zones identifiées dans le but de rechercher les extensions de la minéralisation et de calculer une ressource minière, préalable à une étude de faisabilité.
Elle précisait que, du fait des investissements supplémentaires liés à cette nouvelle phase, l’entreprise rechercherait alors des partenaires, notamment parmi les compagnies minières dites « major ». Manière de dire que l’ « exploitant » de la future mine mettrait déjà un pied dans la place …
Les données estiment à 5% les programmes de recherches minières qui débouchent sur l’exploitation d’une mine. Possible. Mais qui a envie de jouer à la roulette russe quand on connaît les conséquences colossales ?
Déchets :
L’activité minière est donc avant tout une industrie du déchet dangereux. En effet, les métaux ne se décomposent pas et ne sont pas non plus biodégradables.Au mieux, le métal « cible » ne représente que quelques centaines à quelques dixièmes de gramme par tonne de minerai extraite ; plus de 95, voire 99% du volume extrait n’est pas utilisé ou traité et constitue des déchets plus ou moins toxiques (soit des stériles, soit des résidus de traitement). Plus le processus d’affinage avance moins la quantité de déchet est élevée, mais plus ces déchets sont toxiques.
La réglementation impose aux exploitants de la mine une obligation de gestion des déchets pendant 30 ans alors qu’ils restent toxiques et continuent de polluer pendant des siècles, voire des millénaires !
Drainage Minier Acide (DMA) :
L’eau qui entre en contact avec les stériles s’acidifie et provoque la libération des autres métaux dont on a vu qu’ils étaient potentiellement toxiques. Ce « drainage minier acide » ou DMA se déclenche également lorsque l’eau de pluie ruisselle sur les parois des fosses d’extraction d’une mine en surface ou bien, dans les mines souterraines, lorsque les galeries recoupent des circulations d’eau. Autant dire qu’il s’auto-alimente et qu’il est d’autant plus impossible à maîtriser que les volumes et les surfaces concernées sont importantes. Les eaux de ruissellement acidifiées représentent un risque majeur pour les milieux aquatiques à l’aval. La société minière s’engage t’elle à gérer ce problème de DMA sur des millénaires ?
Minerai :
Le minerai (latin minera : mine) c’est une roche qui contient des minéraux (dans le cas présent les métaux) dont on a des raisons de penser qu’ils sont présents en proportion suffisante pour justifier l’exploitation d’une mine. Un minerai ne contient jamais un seul et unique métal, mais un cocktail de métaux (ainsi, parfois, que d’autres substances). Même si cela varie en fonction des sites, pour un métal ciblé par une mine, il est possible de prédire les autres métaux présents dans le minerai ainsi que leur concentration. Plus la concentration d’un métal « associé » sera élevée, plus il a de chances d’être extrait et commercialisé. A l’inverse, plus la concentration est faible, moins il a d’intérêt économique et plus il risque de se retrouver dans les déchets miniers.
Si l’on prend l’exemple de l’or, le gisement produira également un peu d’argent, de cuivre et de zinc mais aussi de l’uranium, de l’antimoine, du baryum, de l’arsenic et du mercure, certes en faible proportion mais dans des volumes tels de déchets que leur impact sanitaire en environnemental sera colossal.
Résidus miniers :
Les résidus miniers sont ce qui reste après le traitement du minerai et l’extraction du métal cible qui implique l’utilisation de réactifs chimiques. Il s’agit généralement d’acides (sulfurique, chlorhydrique, nitrique etc.), de bases (soude, etc.), de cyanure de sodium (pour l’or mais aussi pour la flottation de certains métaux), de xanthates (toxiques à < 1mg/l pour les organismes aquatiques, nombreux cas de contamination de cours d’eaux à l’aval de mines), d’hydrocarbures, etc…
Ces opérations génèrent d’importants volumes de résidus, quelquefois secs mais généralement boueux qui sont généralement stockés derrières des retenues, dont la résistance aux fuites ou aux ruptures n’est pas acquise, l’objectif étant qu’ils se compacifient par évaporation ou drainage, réduisent légèrement en volume et qu’il soit possible d’en rajouter davantage…
Les statistiques mondiales concernant les ruptures de digues à résidus donnent, pour les 30 dernières années, une moyenne de 2 à 5 ruptures majeures par an, soit une fréquence dix fois supérieure à celles de barrages hydrauliques conventionnels. Si les conséquences (pertes de vies humaines, destructions matérielles) pour le territoire à l’aval sont identiques dans les deux cas, les conséquences en termes de pollution chimique sont colossales, impossibles à éliminer et perdureront pendant des millénaires a minima.
Stériles :
Les stériles, c’est la part de la roche ou « minerai » dont la teneur en métaux recherchés est trop faible pour que son traitement soit économiquement viable. Le minerai a été fracturé à l’explosif, puis recassé à l’aide de brise-roches hydrauliques pour pouvoir être déplacé par les chargeuses et camions de la mine, parfois repris pour arriver à des fragments plus petits encore et enfin inspecté pour déterminer la concentration du métal cible. Tout ce qui est sous la barre est qualifié de « stérile » (d’un point de vue financier, rien à voir avec les pansements médicaux !) et sera stocké en verse, halde ou terril qui occuperont des dizaines d’hectares de terrains irrémédiablement artificialisés.
Historiquement, ces verses, haldes ou terrils n’ont jamais été étanchéifiés, ni par le fond ni en surface. La réglementation impose désormais la mise en place de membranes synthétiques à la base et, à la fin de l’exploitation, le recouvrement par une couche de terre avec semis d’herbe. Ce qui pourrait être sécurisant sur le papier laisse perplexe sur le long terme… Qui peut penser que de telles membranes puissent résister pendant des siècles, à fortiori des millénaires, à l’agression chimique de dizaines ou centaines de millions de tonnes de matériaux acides et corrosifs ? La « construction » d’une verse peut durer pendant des décennies, période pendant laquelle les stériles qu’on y accumule sont exposés aux intempéries. Le vent emporte les poussières toxiques à des kilomètres à la ronde, quant à la pluie, elle déclenche et alimente le phénomène de Drainage Minier Acide (DMA).
S’agissant de blocs de tailles diverses, le volume occupé par ces roches est bien plus important que celui du minerai initial (c’est le processus de foisonnement, estimé à entre 30 et 50%). Qu’il s’agisse de mine en surface ou souterraine, il est impossible de tout « remettre dans les trous ». Les surfaces utilisées pour ces stocks de déchets toxiques à perpétuité seront autant d’hectares soustraits aux usages actuels (espaces naturels, agricoles, forestiers, urbains)