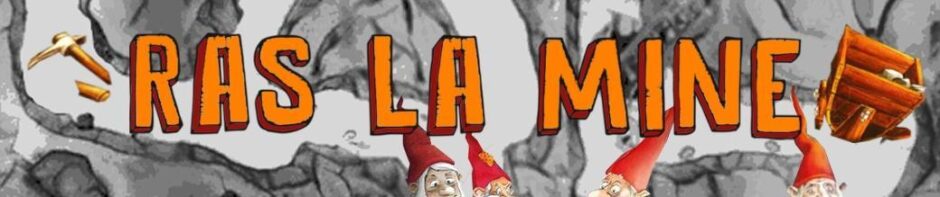[pompé sur lemonde]

Les nodules polymétalliques, précieux galets contenant des métaux rares, qui reposent dans les plaines abyssales, resteront-ils au fond de l’océan, et pour combien de temps ? Au One Ocean Science Congress, un rassemblement de plus de 2 000 scientifiques organisé du 3 au 6 juin, en amont de la Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC), la question taraudait de nombreux chercheurs. L’extraction des minerais rares qu’abrite l’océan profond pourrait en effet avoir des conséquences graves sur ces écosystèmes encore méconnus. Or, les pressions pour l’exploitation commerciale de ces ressources − qui pourraient par exemple être utilisées pour fabriquer des batteries − vont croissant, à commencer par celles de l’industrie minière.
L’entreprise canadienne The Metals Company s’impatiente ainsi de la lenteur des négociations menées depuis une décennie au sein de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). En vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, cette organisation internationale doit encadrer l’exploitation de la « Zone », c’est-à-dire les fonds marins et océaniques, ainsi que leur sous-sol, situés dans les eaux internationales et qui n’appartiennent donc à aucun Etat. La finalisation du code minier est d’autant plus ardue que les positions entre les délégations divergent fortement, allant des pays qui lorgnent ces ressources océaniques à la trentaine d’Etats qui plaident pour un moratoire, une « pause de précaution », voire une interdiction, comme la France
Fin mars, la société canadienne a annoncé faire appel aux Etats-Unis, qui ne sont pas membre de l’AIFM − ayant signé la Convention des Nations unies sur le droit de la mer sans la ratifier −, pour obtenir une autorisation d’exploitation en contournant l’instance internationale. La manœuvre a été largement critiquée par les Etats qui en sont membres, déplorant un coup porté au multilatéralisme. En France, la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a dénoncé un acte de « piraterie environnementale » intervenant hors de « tout cadre juridique ». « Nous ne devons pas les laisser faire », a-t-elle martelé.
Indignation
Mais qu’importe l’indignation de la communauté internationale : Donald Trump a donné sans attendre une première suite à ces velléités d’exploitation des grands fonds. Le 24 avril, le président américain − qui s’inquiète de l’intérêt de la Chine pour ces ressources océaniques − a signé un décret visant à « libérer les minéraux et ressources critiques offshore de l’Amérique ». Il enjoint à son administration d’accélérer les procédures d’examen et de délivrance des permis d’exploration des fonds marins et d’exploitation commerciale dans les eaux fédérales, mais aussi dans les eaux internationales.
Ce texte est « en violation complète du droit international », souligne la juriste Sophie Gambardella, chargée de recherche au CNRS. Dans sa zone économique exclusive, « un Etat peut faire ce qu’il souhaite », rappelle la juriste − mais pas dans ces territoires du large qui n’appartiennent à personne, comme la zone de Clarion-Clipperton, un immense espace situé entre Hawaï et le Mexique que convoite The Metals Company. L’entreprise a fait parvenir aux autorités américaines trois demandes concernant ce périmètre que l’entreprise a déjà partiellement prospecté, par des contrats d’exploration obtenus sous l’égide de l’AIFM.

L’une de ces requêtes porte sur un contrat commercial, sans que ses contours géographiques soient divulgués − The Metals Company n’a pas souhaité les communiquer au Monde. De nombreuses autres inconnues demeurent quant au devenir de cette demande, qui n’a pas encore été validée par les autorités américaines. Donald Trump ira-t-il jusqu’au bout ? Comment la communauté internationale va-t-elle réagir lors des prochaines négociations de l’AIFM, qui auront lieu en juillet ? L’année 2025 avait été initialement fixée comme échéance pour la finalisation du code minier − celle-ci ayant déjà été repoussée à plusieurs reprises.
Répartition des bénéfices
Or, le texte est encore « loin d’être prêt », argue Emma Wilson, chargée de plaidoyer de la Coalition pour la conservation des fonds marins, un regroupement d’organisations de défense de l’environnement. « Nous espérons qu’il n’y aura pas de nouvelles échéances fixées, car cela crée de la pression sur les négociations. » Dans tous les cas, « ce coup de pied dans la fourmilière des Etats-Unis va obliger tous les Etats à prendre position à l’AIFM », estime Sophie Gambardella. Les pays africains, par exemple, « bloquaient les négociations parce qu’ils n’étaient pas d’accord sur la formule de répartition des bénéfices » issus de l’exploitation minière des fonds marins. « Là, le risque, c’est de ne rien avoir du tout », observe la juriste.
Le texte insiste également sur « la nécessité d’accroître les connaissances scientifiques sur les écosystèmes des grands fonds marins ». C’est aussi le credo de nombreux chercheurs et organisations de défense de l’environnement s’inquiétant des conséquences durables de l’exploitation minière sur ces profondeurs océaniques, qui jouent notamment un rôle majeur dans le stockage du carbone. Par ailleurs, les opposants à l’extraction minière des fonds marins remettent en cause l’intérêt de l’exploitation des ressources du plancher océanique au regard de sa rentabilité économique.
Les eaux internationales ne sont pas les seules à susciter l’intérêt des Etats et des compagnies minières. Mi-avril, quelques jours seulement avant le décret du président Donald Trump, la start-up américaine Impossible Metals a ainsi déposé une demande « pour l’exploration et l’exploitation potentielle de minéraux critiques (…) au large des côtes des [îles] Samoa américaines », en Océanie. En Europe, plusieurs entreprises espèrent pouvoir extraire les ressources des profondeurs norvégiennes. Le gouvernement du royaume scandinave a renoncé, fin 2024 à délivrer des permis de prospection − mais pour un an seulement.